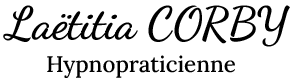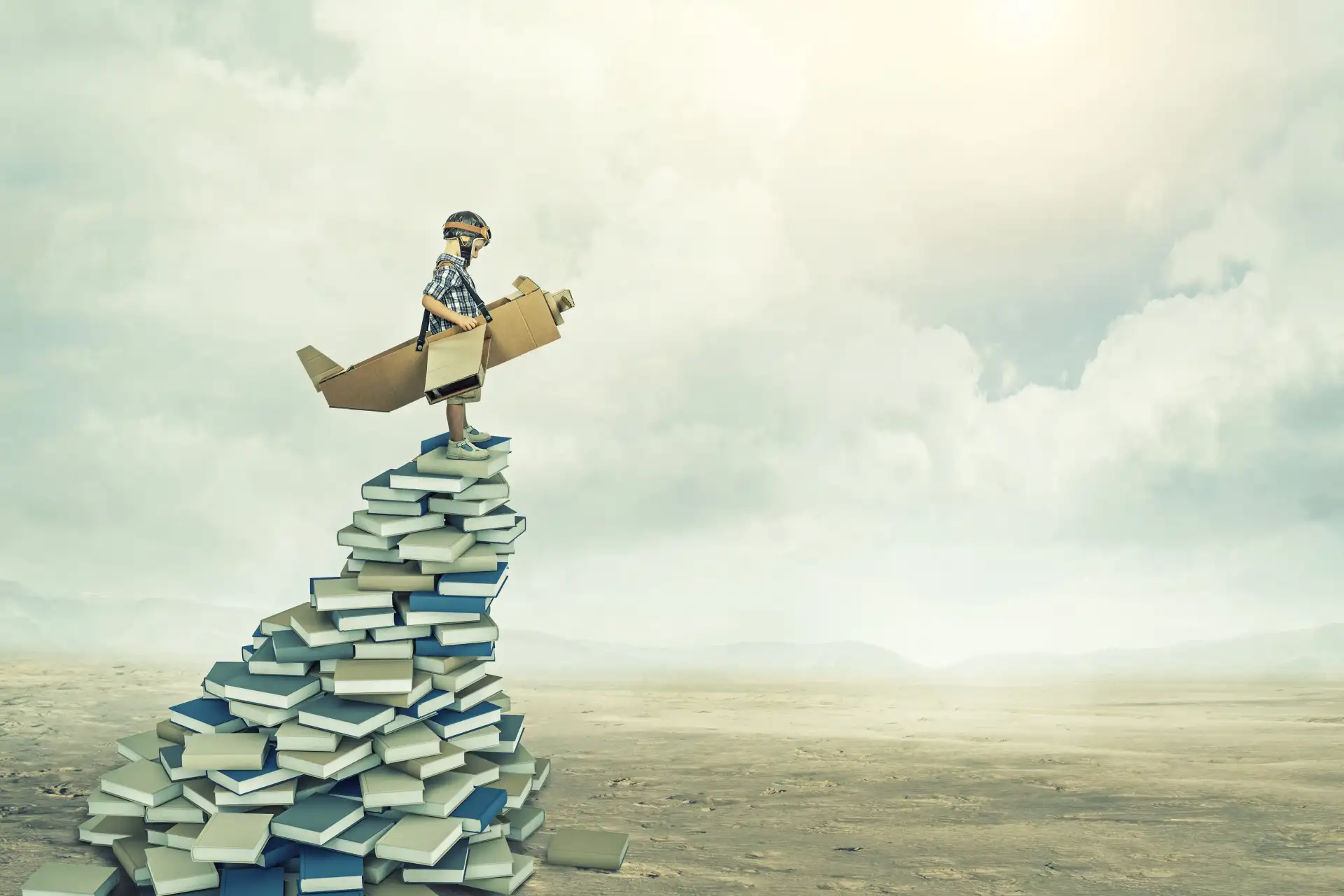Adultes
Adultes
Hypnose à Muret

Je suis Laetitia Corby, hypnopraticienne spécialisée en hypnose ericksonienne, et je suis là pour vous accompagner dans votre quête de bien-être, de changement et de transformation. Je me suis spécialisée notamment en hypnose périnatale et en hypnose pour enfants et adolescents à Muret.
Ce que nous pouvons travailler ensemble
- Arrêt du tabac
- Perte de poids
- Manque de confiance en soi
- Anxiété
- Insomnie
- Peurs & phobies
Une approche complète pour votre bien-être
Je suis passionnée par le pouvoir de l'hypnose pour apporter des solutions positives à différents aspects de votre vie. Que vous soyez à la recherche de techniques pour gérer le stress, l'anxiété, ou pour renforcer votre confiance en vous, l'hypnothérapie offre un chemin vers un mieux-être profond.
Accessibilité et engagement
Les tarifs sont abordables, à 70€ par séance d'une heure. Que vous cherchiez à améliorer votre qualité de vie, à surmonter des défis ou à vous transformer, l'hypnose peut être votre alliée dans ce voyage.
Contactez-moi pour planifier une séance d'hypnose
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations ou pour planifier une séance. Je suis là pour vous accompagner dans votre cheminement vers un bien-être épanouissant.
Je vous attends avec impatience pour démarrer ce voyage ensemble.
 Ethique & Déontologie
A l’ARCHE, nous pensons qu’il est important de promouvoir une hypnose de qualité, fondée sur des principes et une éthique claire. Adhérente à la charte éthique de l’A.R.C.H.E. ainsi qu’au code de déontologie.
Ethique & Déontologie
A l’ARCHE, nous pensons qu’il est important de promouvoir une hypnose de qualité, fondée sur des principes et une éthique claire. Adhérente à la charte éthique de l’A.R.C.H.E. ainsi qu’au code de déontologie.
 Limites
L’accompagnement par l’hypnose n’est pas une médecine et donc, ne guérit pas les maladies. Seul un médecin est habilité à poser des diagnostics, prescrire ou supprimer un traitement médical. Si vous avez un traitement, faites m’en part et poursuivez-le.
Limites
L’accompagnement par l’hypnose n’est pas une médecine et donc, ne guérit pas les maladies. Seul un médecin est habilité à poser des diagnostics, prescrire ou supprimer un traitement médical. Si vous avez un traitement, faites m’en part et poursuivez-le.
 A votre écoute
Une séance d’hypnose est un accompagnement vers des solutions. Pour rendre la séance encore plus efficace, il est indispensable d’avoir un engagement personnel important ainsi qu’une certaine motivation.
A votre écoute
Une séance d’hypnose est un accompagnement vers des solutions. Pour rendre la séance encore plus efficace, il est indispensable d’avoir un engagement personnel important ainsi qu’une certaine motivation.